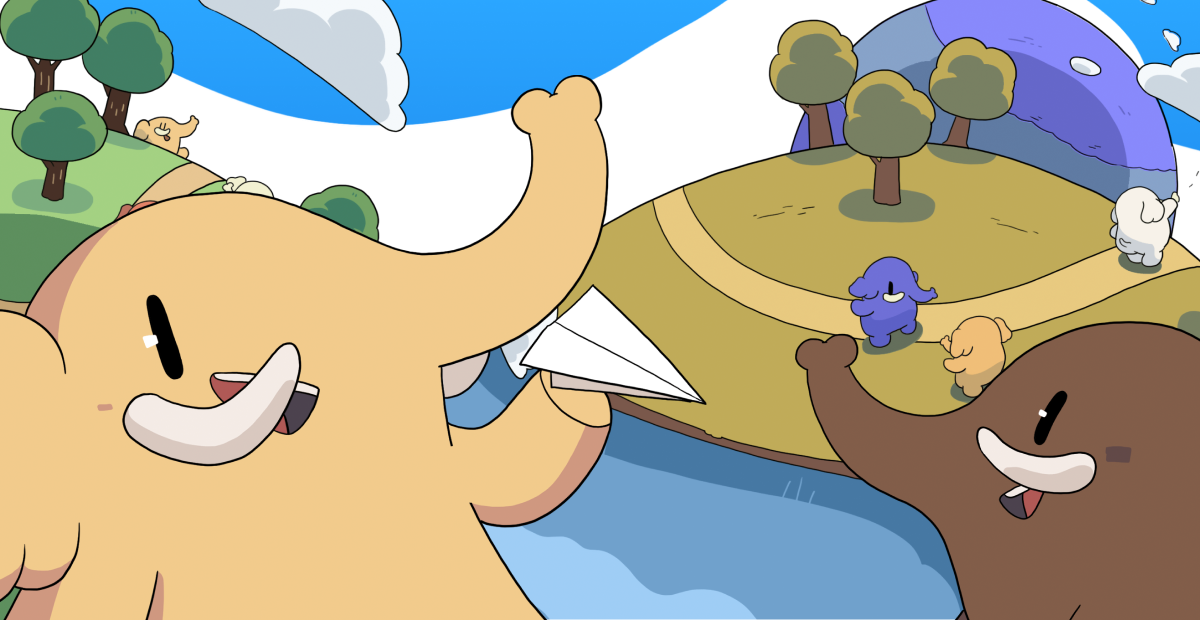La catastrophe industrielle de Manfredonia (Pouilles, Italie. 1976)
Un extrait du livre de Stefania Barca, Workers of the Earth. Labour, Ecology and Reproduction in the Age of Climate Change, Pluto Press 2024.
https://outsiderland.com/danahilliot/stefania-barca-sur-la-catastrophe-de-manfredonia/
Un des points aveugles de la propagande en faveur l’éthique du travail (ou la « valeur travail »), c’est la catastrophe industrielle. toutes les régions du monde dans lesquelles se déploient les usines et les infrastructures du capitalisme industriel ont connu leurs catastrophes. Les plus spectaculaires scandent l’histoire du capitalisme. Pour ne prendre que des épisodes récents, Seveso, Bhopal, Tchernobyl, hantent (ou devraient hanter) les mémoires des habitant‧e‧s de cette planète. La vérité, c’est qu’on les oublie vite : quelle trace a laissé dans la mémoire des européens l’explosion d’un stock de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium dans le port de Beyrouth en août 2020 ? Qui se souvient des 1127 morts et des milliers de blessés lors de l’effondrement de l’atelier de confection Rana Plaza à Dacca (Bangladesh) en 2014 ?
Pire encore que l’oubli, il y a l’ignorance pure et simple. Parce que la catastrophe industrielle n’est pas toujours spectaculaire. Les effets les plus courants de la production industrielle s’inscrivent dans ce qu’on appelle en anglais les « slow disaster » : pensez à la différence entre un tsunami dévastateur, et la montée des eaux telle qu’elle se manifeste à l’ère du changement climatique. Rob Nixon, dans son ouvrage désormais classique, The Slow violence and the environmentalism of the poor, 2011, s’inscrivant dans une longue tradition de recherches, avait rappelé combien ces effets toxiques de l’activité industrielle touchent d’abord et avant tout les classes les plus défavorisées, et pas seulement dans les territoires d’exploitation néocoloniaux. Cette tradition critique remonte déjà au XIXè siècle, on en lit des échos par exemple chez Marx, mais elle se développe surtout depuis les années 60, dans tous les milieux critiques et militants, écologistes, féministes, indigénistes etc. On peut les rassembler par commodité dans la catégorie de la « justice environnementale » – en gardant à l’esprit le caractère social et politique de l’ « environnemtal justice » (qui se distingue de ce point de vue des perspectives « environnementalistes » conservatrices classiques – défendre une nature « pure » fantasmée en dépit des êtres humains qui l’habitent et la transforment).
Les impacts les plus mortifères et destructeurs de l’activité industrielle (et plus largement, de toute la chaîne de production capitaliste, depuis l’extraction jusqu’à la livraison du produit fini, en passant par la fabrication, la transformation, les infrastructures militarisées des transports, etc.) sont sournois, bien qu’omniprésents, et parce qu’ils se déploient progressivement, lentement, et ne se manifestent souvent qu’après des années, voire des décennies, notamment dans le cas des cancers et autres pathologies touchant notamment les personnes les plus fragiles, à commencer par les nouveau-nés, ces effets sont aisément invisibilisés par les capitalistes. Ces empoisonnements systémiques sont d’autant plus aisément occultés par les responsables que les faits épidémiologiques ou environnementaux, pour être établis objectivement, requièrent le concours des scientifiques, c’est-à-dire d’une expertise dont les ouvrières du textile au Bangladesh ou les parents des enfants malformés à la naissance dans les zones industrielles ne disposent pas. La reconnaissance des effets sur la santé et l’environnement de l’activité de production repose inévitablement sur l’alliance des victimes et des scientifiques, ce qui pose d’évidents problèmes : car, du côté des responsables, on se fait fort de financer des expertises qui tendront à rassurer, c’est-à-dire le plus souvent à minimiser, voire à occulter, ces effets – et, dans le meilleur des cas, le débat se déplace entre deux expertises, deux communautés scientifiques, l’une, grassement payée, au service du capital, et l’autre, du côté des militants, souvent composée d’étudiants ou de chercheurs et chercheuses issues de l’université, beaucoup moins bien rémunérés, voire pas rémunérés du tout.
J’en viens maintenant au récit que Stefania Barca fait d’une catastrophe dont on ne trouve que très peu de traces dans les médias ou sur internet. Celle de l’usine de Manfredonia, dans les Pouilles italiennes en 1976, à la fois éclipsée par la catastrophe de Seveso, qui s’était produite deux mois auparavant, et aisément occultée parce qu’elle se déroulait dans une ville du sud de l’Italie, et non pas dans le Nord – une des conséquences de cette situation géographique, c’est notamment, comme on le lira, l’absence de « prise de conscience » politique, syndicale et des milieux médicaux. La lutte, car lutte il y eut, difficile et mal récompensée, vint d’abord des populations locales, des femmes notamment.
Lire la suite sur mon blog !